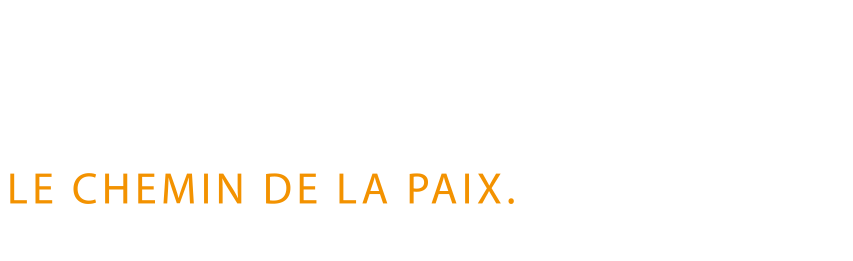(Sud Ouest) Forum pour la paix de Bayonne : la leçon irlandaise
Publié le 16/12/2012 à 06h00 , modifié le 16/12/2012 à 14h47 par
Pantxika Delobel
L’avocat sud africain Brian Currin, acteur clef dans la résolution du conflit irlandais participe, ce dimanche au Forum pour la paix de Bayonne. Témoignage d’un expert.
Depuis plus de trois ans, cet homme, stature haute, regard sage et mallette noire à la main, va et vient dans les coulisses. Rencontré jeudi soir dans le salon ouaté d’un hôtel de Saint-Sébastien, Brian Currin abandonne son ordinateur portable sur un fauteuil, le temps d’une interview.
Brillant avocat spécialiste des droits de l’Homme, il explique, dans un anglais châtié, son rôle de « facilitateur de la paix ». Acteur clef dans la résolution de nombreux conflits, ce Sud-Africain mène désormais le Groupe international de contact (GIC) chargé d’instaurer le dialogue au Pays basque. Si, à ce jour, son rôle n’est pas (officiellement du moins) reconnu par le gouvernement espagnol, ce dernier semble néanmoins laisser faire le « médiateur » Currin.
Vous êtes un des artisans du processus de paix en Irlande du Nord. Est-il juste de le comparer avec celui qui se déroule actuellement au Pays basque ?
C’est difficile à dire. Ici, le processus de paix n’en est qu’à ses débuts. Ces trois dernières années, je me suis rendu compte que le processus basque ne pourrait aboutir à un succès tant qu’ETA ne cesserait pas son activité armée et tant que la gauche abertzale serait exclue des institutions démocratiques. Mais grâce au travail acharné des partis politiques, de certains représentants de la société civile, des ONG, comme Lokarri, et de la société basque en général, nous y sommes parvenus. Alors, je ne peux pas comparer le contexte basque et le contexte irlandais, mais il y a de nombreuses similitudes.
En Irlande, unionistes et républicains ont refusé le dialogue durant des années. Comment la situation s’est-elle débloquée ?
Il y a eu des négociations secrètes entre l’IRA, les républicains et le gouvernement britanniques durant des années. Et durant des années, les unionistes ont refusé de parler directement aux républicains. La commission dont je faisais partie les avait même emmenés sur un terrain neutre, dans un hôtel en Afrique du Sud. Mais même là, ils ne se parlaient que par le biais d’intermédiaires. Les premiers échanges, directs, ont eu lieu quelque temps après l’accord du Vendredi saint (1). Mais ce n’est pas le cas au Pays basque. Par rapport à l’Irlande, nous sommes à un stade avancé de la « normalisation politique ». Aujourd’hui, EH Bildu et le Parti populaire sont assis côte à côte au parlement basque.
Et croyez-vous qu’il y ait des contacts entre ETA et le gouvernement espagnol ?
Si on l’ignore, c’est peut-être le signe que des négociations ont commencé. Il est normal que des discussions de ce genre restent discrètes. En Afrique du Sud, il y a avait des rendez-vous secrets entre d’influents Afrikaners proches du pouvoir et l’ANC (Congrès national africain) durant près de deux ans. Ces entretiens se déroulaient sous couvert des plus hauts services de sécurité du gouvernement et de Nelson Mandela, alors qu’il était en prison.
Durant le processus de paix en Irlande, la police a-t-elle continué à interpeller des militants de l’IRA, comme c’est le cas au Pays basque?
Non. Le gouvernement britannique n’a jamais agi unilatéralement en interpellant les clandestins. Mais parce qu’un autre degré du processus avait été franchi. Après l’accord du Vendredi saint, une commission a vu le jour pour s’occuper de la libération des prisonniers de l’IRA. Cette entité que je présidais a exigé des militants en fuite de se rendre eux-mêmes. La règle établie voulait qu’ils soient arrêtés, qu’ils passent devant cette commission. S’ils n’avaient pas servi trop longtemps au sein de l’organisation, ils étaient relâches immédiatement. Les autres passaient deux ans en prison avant d’être libérés.
C’est pourquoi, il est important que les gouvernements français et espagnol dialoguent avec ETA. Non pas pour débattre de l’avenir politique du Pays basque mais pour parler des conséquences du conflit. Une de ces conséquences, ce sont les armes. Ces armes ne peuvent pas être déposées sur le bord de la route. Les militants doivent les rendre à quelqu’un, mais à qui ? Pas à une autre organisation criminelle. Ce processus doit être encadré.
Une autre conséquence de ce conflit est qu’il y a toujours 700 personnes en prison. Dont certaines auraient dû être libérées depuis longtemps. Maintenant que le Pays basque vit en paix, Madrid et Paris doivent accepter cette nouvelle réalité.
Après l’accord du Vendredi saint, tous les prisonniers impliqués dans la violence ont-ils été amnistiés ?
L’amnistie ne faisait pas partie de l’engagement passé entre la commission, le gouvernement et l’IRA. La question des prisonniers était, comme au Pays basque, très sensible et, bien entendu, nombre de victimes de l’organisation se sont senties bafouées lorsque les détenus ont commencé à être libérés. La plupart d’entre eux l’ont été deux ans après signature de l’accord contre promesse de ne pas retomber dans la violence, faute de quoi ils devraient purger toute leur peine
(1) Accord de paix signé le 10 avril 1998 pour mettre fin au conflit en Irlande du Nord.